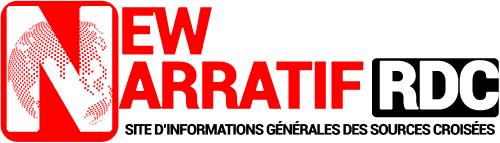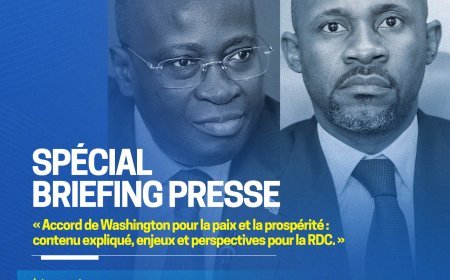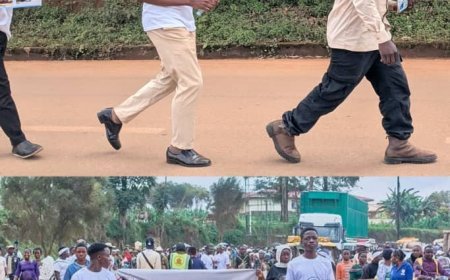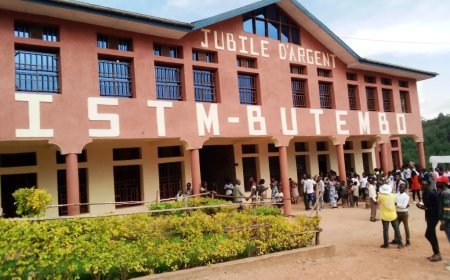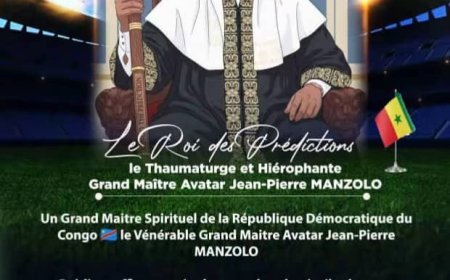Dialogue en RDC : Une voie historique ou une impasse ?

Alors que la République démocratique du Congo est plongée dans une crise multidimensionnelle, l'appel au dialogue résonne à nouveau, ravivant un débat ancestral : est-il la solution ou une simple fuite en avant ? Pour beaucoup de Congolais, les dialogues passés n'ont servi qu'à prolonger des régimes ou à signer des accords jamais appliqués. Mais cette vision, qui tend à condamner d'emblée tout nouveau processus, fait fi de l'histoire. Car si le dialogue n'est pas une formule magique, il a toujours été une réponse à une crise de légitimité, un problème qui hante la nation depuis des décennies. Revenir sur ces moments clés permet de comprendre que chaque dialogue a eu un rôle, même imparfait, dans la construction du pays.
La Conférence Nationale Souveraine (1991-1992)
Face à la pression populaire et internationale, le Zaïre de Mobutu a ouvert la porte à la Conférence Nationale Souveraine. Ce fut le premier grand moment de libération de la parole pour les Congolais. La CNS a non seulement permis de dresser un état des lieux de la nation, mais elle a aussi posé les bases d’une transition démocratique en élisant Étienne Tshisekedi au poste de Premier ministre. Son résultat a été un échec, car les jeux de pouvoir ont eu raison de la transition, mais son apport symbolique a été immense. Il a montré qu'une alternative était possible.
Le Dialogue Inter-Congolais (2002) : la paix au prix des compromis
Après des années de guerre dévastatrice, le Dialogue Inter-Congolais (DIC) à Sun City a été un tournant. Considéré comme le plus grand succès des dialogues congolais, l'Accord de Sun City a mis en place un gouvernement de partage de pouvoir et a jeté les bases de la Constitution de 2006. Sans cet accord, il est fort probable que les premières élections démocratiques en plus de 40 ans n'auraient pas eu lieu.
L'Accord de la Saint-Sylvestre (2016) : une victoire de la diplomatie interne
L'échec du Dialogue de la Cité de l'Union Africaine en 2016, jugé non-inclusif, a mené à une nouvelle escalade des tensions. C'est l'intervention des évêques de la CENCO qui a permis de rassembler toutes les parties et de signer l'Accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord a été une victoire de la diplomatie interne et a permis de relancer le processus électoral, même si son application difficile a finalement conduit à de nouveaux retards.
Le dialogue est-il encore une nécessité ?
Face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays, la réponse est oui. Le président Félix Tshisekedi affirme être ouvert au dialogue, mais insiste pour qu'il soit une initiative congolaise, excluant les "inféodés de l'extérieur". Cette position montre une volonté de souveraineté, mais l’histoire nous rappelle que le succès d'un dialogue réside dans son inclusivité.
Cependant, la vision du dialogue doit évoluer. Le dialogue n'est pas une simple table de négociations pour le partage de postes. Pour résorber les crises actuelles, la table des négociations doit devenir celle de la vérité et de la justice. Il est impératif que les voix des victimes soient entendues et que les coupables, quel que soit leur camp, soient tenus pour responsables. Un tel dialogue, fondé sur la redevabilité et la justice, est le seul à même de restaurer la paix et la dignité du peuple congolais.
En fin de compte, le dialogue n'est pas un échec en soi, mais une étape dans un processus complexe. Les leçons du passé nous apprennent que si les accords signés ne garantissent pas toujours des solutions durables, ils restent indispensables pour que la nation puisse se réinventer et aller de l'avant. Le dialogue ne va pas résoudre tous les problèmes du Congo, mais il est un passage obligé pour éviter le pire.
Guyvenant Misenge